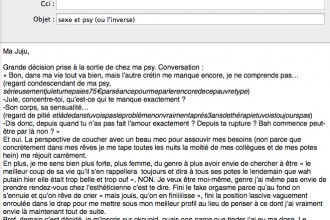Nous avons beau être un public facile quant il s’agit de bloc-buster super-héroïques, nous ne pouvons qu’abdiquer devant l’évidence: Suicide Squad est un mauvais film. Ce n’est sûrement pas le plus mauvais des méfaits DC, dont la direction artistique, à la poursuite des galopants studios Marvel, semble joyeusement s’enfoncer dans sa spirale d’affligeantes productions cinématographiques (Les 4 Fantastiques, Dawn Of Justice pour ne citer qu’eux). Disons que nous ne sous sommes pas faits chier en le regardant; nos yeux ne se sont pas – trop souvent – retournés dans leur orbite en signe d’affliction absolue; nous ne nous sommes pas cachés le visage dans une moue affligée. Mais ça ne va pas plus loin, et le visionner au cinéma où explosions en tout genre sont assez pour nous abrutir les synapses a beaucoup participé à notre magnanimité (essayez de mater Star Wars Episode VII sur votre petit écran). Scénario tenant dans un Haïku, méchants héros aux traits grossiers dont il ne faudra qu’une heure pour se considérer comme une famille et qui, de fait, n’arrivent pas à la cheville de leur miroir marvellien Deadpool, mauvais tempo rendant toute tentative de blague presque gênante… Mais ne retenons qu’un échec – reflétant tous les autres -: la trahison qu’est le traitement du personnage Harley Quinn. Parce que malgré le jeu volontaire de Margot Robbie, Harley n’atteint jamais la cheville des ambitions d’un film qui, comme l’a méchamment décrit Buzzfeed « se veut anguleux mais ne peux dépasser les courbes de son lead féminin« . Parce qu’Harley est un des personnages les plus complexes de la mythologie DC, et que la peindre à gros coups de simplisme et de sexualisation tient de la traîtrise. Enfin, parce qu’il faut un peu de génie pour correctement donner vie à une héroïne estropiée par une relation abusive, sans romantisation ni jugement moralisateur; peine perdue ici.
Le cas Harley Quinn
La campagne marketing de Suicide Squad laissait pourtant présager du bon, particulièrement concernant son personnage central, héroïne « juive, queer, à la morale discutable, profondément imparfaite et aimée par des millions de fans« . L’incarnation de Margot Robbie supposait la volonté de synthétiser toutes les différentes représentations du personnages à travers les ères DC: talons et shorty pupute rappelant la période Arkham, blagueuse invétérée dont les sourires suintent la folie furieuse (période Suicide Squad le comics), sidekick barrée et amoureuse malheureuse. Peine perdue. Explications.
Harley Quinn (créée par Paul Dini, Bruce Timm et Arleen Sorkin) est l’archétype du Héros ambivalent; en ce sens, sûrement l’une des plus belle réussites des studios DC. Ancienne psychiatre tombée folle amoureuse du Joker pour qui elle subira de drastiques transformations identitaires et physiques, Harley est un personnage constamment abusé par son poussin avec lequel elle entretient une relation à la mécanique bien huilée (il la maltraite, elle s’en défait plus ou moins volontairement (il attente régulièrement à sa vie), elle veut le tuer, y parvient presque, revient vers lui etc. Pour un bon aperçu de cette dynamique, voir l’épisode Harlequinade), mais également l’une des femmes les plus emblématiques de la galaxie comics. Pour tenter de la saisir dans toute sa complexité et embrasser l’échec de Suicide Squad à la dépeindre, il nous faut revenir sur sa sucess story.
Elle est introduite en 1992 comme sidekick du machiavélique clown dans Joker’s Favor. L’épisode brosse ses principaux traits de personnalité: son amour psychotique pour le Joker mais également son intelligence, sa folie virevoltante et son humour non conformiste. L’épisode fut un succès et marqua le début d’une carrière toujours exponentielle sur les 7 années qui suivirent. Récurrente dans la série, elle fit sa véritable entrée dans le comics en 1994 via Mad Love – épisode narrant les origines de sa relation destructrice, qui remporta le Eisner – et devint un personnage canonique de la série comics à partir de 1999 (récurrente dans Birds of Prey, Gotham Girls…).
Deux ères, deux versions :
L’histoire d’Harley se complexifie, entre autre par le truchement des changements opérés à travers les différents supports. Il y a par exemple une différence notoire entre la série télévisée et le comics, puisque le second développe un Joker bien plus malade et sadique que dans le cartoon. Difficile alors d’éluder la perversité de leur relation par une commode pirouette rhétorique de Harley. La différence s’accentua d’avantage dans la série de jeu vidéo Batman – Arkham, virage sur-sexualisé du personnage (développé par le reboot comics de 2011, Suicide Squad). A ceux qui nous accuseront de « féministes frustrées s’insurgeant au moindre bout de chaire dévoilé », nous répondrons que tout d’abord, cette direction graphique occasionna de tumultueux désaccords entre les paternels de la donzelle, Dini et Timm. Ensuite, elle n’aurait pas gêné si la force et l’indépendance du personnage avaient suivi en conséquence. Or, alors qu’elle avait depuis 1994 entamé une transformation vers une individualisation sans son psycho de clown, le jeu cantonne Harley au rôle de jolie sidekick/sexy punchingbag. Comme le Joker l’affirme lui même: « You had to spoil everything: beating up Bane, feeding Scarecrow to Croc, slapping around Harley — my hobby, by the way« .
Néanmoins, à ceux sous-entendant qu’Harley ne peut exister par elle-même, revoyez votre copie; DC ne lui a pas consacré un mois entier (février 2015: le mois d’Harley Quinn) sans raison. Sa relation amicale/amoureuse avec Poison Ivy, qui la recueillera après une énième tentative de meurtre du Joker, fut notamment l’occasion de développer le personnage dans toute sa force indépendante et féministe. Non seulement elle parvint à se détacher de son Némésis peinturluré mais alla jusqu’à créer un gang exclusivement féminin composé de « Red » et de la féline Catwoman. Et c’est en 2013 qu’elle obtint enfin son propre comics (créé par Amanda Conner and Jimmy Palmiotti) où elle évolue libre de l’influence du Joker. Malgré un lancement chaotique, cette série deviendra l’une des mieux vendues de DC: à maintes reprises, Harley fut l’héroïne féministe que nous avions tous attendue.
« Life used to be so placide. Won’t you please put down that acide ? »
Si l’histoire a été revue au grès des évolutions et changements de support, DC a déployé 25 années d’une chronologie torve et composite. Si Harley Quinn est la représentation même de la femme cloîtrée dans une relation destructrice, les créateurs ont fait preuve d’assez de sagacité pour ne jamais la réduire à ce statut. Harley a eu un quart de siècle pour démontrer qu’au delà de son amour pour Mister J, elle était une femme brillante, dangereuse par elle même, barrée (particulièrement dans la série comics Suicide Squad), forte (elle est l’une des seules à capturer Batman pour en faire cadeau au Joker…), faible (…et de jalousie, il la balancera par une fenêtre, geste qu’elle excusera par un triste « my fault« ) et extrêmement drôle. Le point est même des plus intéressants si l’on suit ce fil de réflexion: une femme n’a pas besoin d’être « faible » pour tomber dans le cercle infernal de la relation abusive; elle n’est pas non plus déterminée à n’exister que par le prisme exclusif de cette relation. En somme, les auteurs se sont bien gardés de tomber dans la fétichisation de la liaison avec le Joker: Poison Ivy, par exemple, ne manque jamais de mots durs pour décrire le comportement de Harley. L’index moralisateur n’est pas non plus tendu lorsque la belle revient inexorablement vers son bourreau, et si Harley déploie souvent une rhétorique commune chez les victimes d’abus domestiques, elle fait également preuve de grands moments de lucidité (parfois crûment, parfois avec cet humour laconique qui lui sied si bien).
Harley, le meilleur et le pire de Suicide Squad
Suicide Squad tente donc de rassembler 25 ans d’histoire en un personnage. Margot Robbie, en essayant d’être toutes les Harley n’en est finalement aucune, et certainement pas la highly functionning sociopath pleine d’humour que nous aurions voulu voire cabrioler hors de la nauséabonde influence du Joker.
Le film pousse de manière peu subtile les pseudo force et féminisme d’Harley: elle est présentée par le retro “You Don’t Own Me” (faux, si nous suivons sa dévotion aveugle pour le Joker) et balance ce beau cliché à la figure de son geôlier: “I sleep where I want, when I want, with whom I want”. Cette introduction est non seulement en contradiction avec son état présent (enfermée, maltraitée, finalement toujours prisonnière d’un joug masculin) et est loin de s’avérer exacte par la suite. Pour exemple, que serait-il advenu si le Joker avait poussé jusqu’au bout sa plaisante farce d’offrir sexuellement Harley à un de ses partenaires ? On pourrait nous rétorquer que Harley choisit d’obéir au Joker. Mais ne soyons pas dupes: nous savons intimement que l’illusion du choix ne se fait jamais autant sentir que lorsque des sentiments “amoureux” se mêlent à la tourmente.
Sur cette problématique, nous ne partageons pas l’argument commun avancé pour défendre le « féminisme » d’Harley, qui choisirait ce comportement. Oui à la capacité d’élire, au droit de se tromper ou d’opter délibérément pour la mauvaise option; le personnage n’en est que plus intense, profond et complexe. Mais qui y a-t-il de féministe à glorifier, sexualiser et fétichiser une femme piégée dans une relation délétère ? Les coups ne sont pas les preuves d’un amour dévorant. Les cris ne sont pas synonymes de passion amoureuse. Un monstre ne se transforme jamais en prince charmant (merci La Belle & La Bête pour ce beau mensonge, au passage). Que la violence revête une aura sexy dans le calfeutré d’un fantasme, soit. Mais il n’y a rien de bandant à regarder une femme brillante se faire détruire physiquement et psychologiquement par un pervers dont on pardonne le sadisme parce que « fascinant ».
Deuxièmement: pour traiter le féminisme d’Harley, le postulat du film est d’en faire l’actrice consentante des abus subits – le problématique choix. D’où une scène où elle plonge dans une cuve de produits chimiques – sous l’impulsion du Joker – plutôt que d’y être jetée, comme dans le comics. Malheureusement, la pilule est bien trop grosse pour être avalée sans réflexe laryngé: par son jeu mécanique et mutique, Robbie matérialise un personnage hypnotisé par son bourreau bien loin de toute dynamique d’élection, l’exemple type d’un être en plein syndrome de Stockholm plutôt qu’une héroïne en possession de ses moyens, donc de ses choix. Et tout ce cirque ne semble qu’une vaine entourloupe pour préparer le spectateur au vrai climax: le bon Joker revient chercher sa douce. Là où le comics a mis si longtemps à faire de Harley un personnage existant par lui même, le film nous ramène à la case départ.
#RelationshipGoals ? Certainement pas.
Sans partir dans des généralités réservées à nos soirées dominicales au PMU, les relations amoureuses ont toujours été un épicentre mettant le plus clairement en lumière notre attirance et fascination sado-maso pour la violence. Moteur artistique privilégié, nous ne comptons plus les œuvres qui puisent leur sève dans des modèles vrillés (petite mention au duo Rihanna/Eminem, la première étant l’archétype de la femme impénitente, ce qui ne l’a pas empêchée de se faire tabasser par son ex, et le 2ème ayant multiplié les ritournelles fantasmant sur le meurtre de Kim, la mère de sa fille. On vous fera une playlist). Néanmoins, la vie vous rappelle assez rapidement à la réalité de ces liaisons abusives: des gouffres émotionnel et physique dont certains ne s’extirpent que difficilement, voir les pieds devant. Il y a donc une véritable difficulté à peindre une relation destructrice sans jugement ni fétichisation. Ce travail oblige à une prise de recul et une grande intelligence; c’est sur ce point précis que Suicide Squad trahit le plus explicitement le travail original de DC avec Harley Quinn.
D’ailleurs, contrairement au comics qui refusait le modèle d’une petite amie humanisant le Joker, l’idée d’une mitigation des abus de ce dernier sur Harley est omniprésente dans Suicide Squad: il tente de la « sauver » (parce qu’elle a évidemment besoin d’être sauvée), la mettant perpétuellement en danger. Il l’offre à un de ses partenaires, validant l’objectification que les créateurs originels avaient soigneusement évitée, mais finit par exploser la tête de ce dernier; une bonne blague, somme toute. Et la belle finit par retourner, tout sourire, dans les bras de son bourreau (ce qu’elle ne fait que rarement gratuitement dans le comics/cartoon), mettant en place les ingrédients pour une suite dont il sera le héros. Finalement, toute la force qu’Harley possède ne semble être que prétexte pour des plans sur son physique et des flashbacks laissant la part belle au Joker; pire, le film est assez pauvrement monté et superficiellement traité pour que le spectateur finisse par dangereusement légitimer les abus commis sur la belle.
Harley est donc dans la demi-teinte et l’insipide permanents. Elle est folle; mais pas trop. Elle embrasse parfois son côté de vilaine; mais pas trop non plus, son rêve absolu étant celui d’une vie pavillonnaire avec enfants, golden-retriever, crédit et son poussin redevenu le beau Jared Leto pour l’occasion. A la place d’une tornade imprévisible, nous avons droit à une poupée hyper-sexualisée aux blagues attendues, une brise légère qui gentiment vous caresse là où ça chatouille mais jamais ne vous gifle là où ça fait mal.
En somme, un personnage sophistiqué dont la psyché est ancrée dans une relation abusive – mais pas que – oblige à composer avec toutes les gammes de la complexité humaine. Ce n’est jamais le cas de Suicide Squad. Du coup, pour le spinoff qui risque d’arriver, nous avons quelques requêtes aux futurs réalisateurs concernant Harley: mettez lui un pantalon et des talons de taille raisonnable (histoire de nous titiller au dessus du ceinturon, et parce que même Simon Biles ne peut virevolter en Louboutin). Virez le Joker (quitte à lui consacrer un film; c’est péché de ne l’avoir fait apparaître que 15 minutes). Faîtes revenir l’amante Poison Ivy. Redonnez à Harley Quinn toute l’intelligence, la force et l’imprévisibilité qui ont fait succès. Libérez-la.
Sources: ici, là, encore ici, là, et là aussi. Et bien sûr ici. Et là.